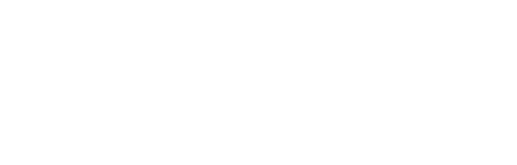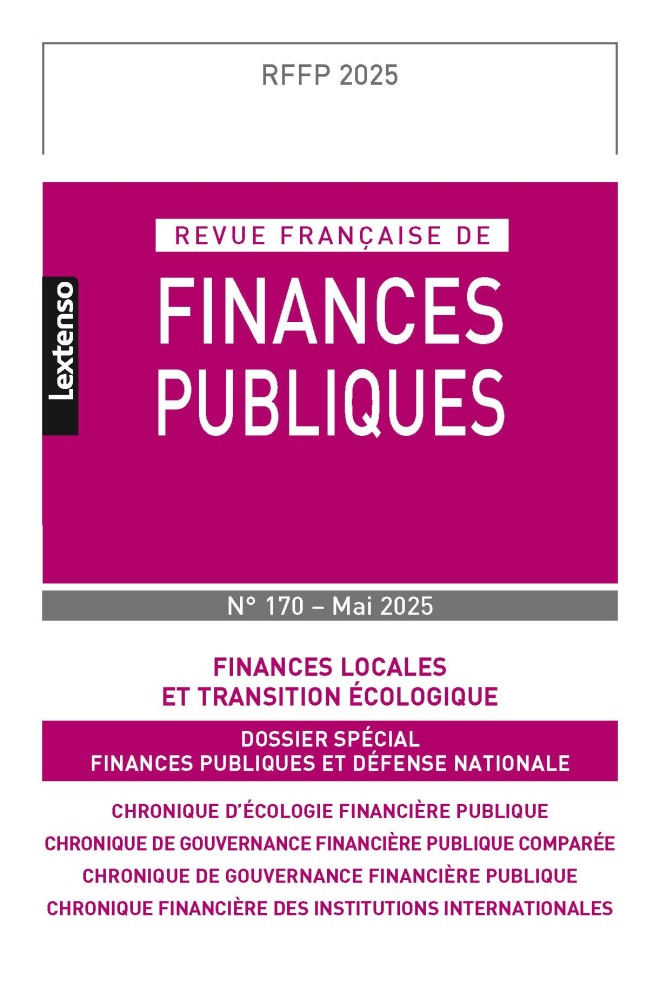Éditorial
Libéralisme vs protectionnisme : un faux paradoxe, un vrai changement d’époque ?
La voie mise en œuvre de manière spectaculaire par le nouveau président des États-Unis, avec la bénédiction d’Elon Musk, peut sembler paradoxale dans la mesure où elle comporte deux conceptions à priori antinomiques, un ultra libéralisme et un ultra protectionnisme.
Or, il n’en est rien. Il ne faut en effet pas s’y tromper, cette voie n’a rien de surprenant non seulement parce qu’elle figurait déjà dans le programme du candidat républicain mais plus fondamentalement parce qu’elle s’inscrit parfaitement dans une mutation des idées et des opinions qui s’épanouit peu à peu depuis maintenant une cinquantaine d’années sur la base d’une libéralisation du marché économique et d’une limitation de l’État à ses fonctions régaliennes, le tout sur fond d’un illibéralisme politique plus récent. Il en résulte un modèle de société comportant deux pôles, un pouvoir politique centralisé et un pouvoir économique qui tend à se délivrer de toutes formes d’interventions du secteur public.
Ce n’est pas tout. Il faut encore souligner que le caractère contradictoire de ce modèle n’est qu’apparent pour une autre raison. Il rappelle en effet sur des points essentiels celui qui était en vigueur au 19e siècle et qui ressurgit dans un contexte totalement inédit.
En effet, l’État d’alors, que l’on a qualifié d’« État-gendarme », n’intervenait financièrement, en matière économique, que d’une façon limitée et ponctuelle et s’abstenait en matière sociale.
Question de principe, puisque ses options, équilibre budgétaire, recours très modéré à l’emprunt, neutralité de la monnaie, le lui interdisaient. Mais aussi problème de moyens, puisqu’avec des ressources limitées cet État était dans l’impossibilité de se transformer en agent économique ou en protecteur efficace.
Néanmoins, ce serait faire fausse route que d’imaginer que le pouvoir politique de cette époque était absent de la vie économique. Cela relèverait d’une vision quelque peu reconstruite et déformée de la réalité. Celle-ci est infiniment plus complexe, libéralisme économique et protectionnisme peuvent parfaitement cohabiter. La preuve en est que l’État d’alors n’a jamais hésité à utiliser les droits de douane pour protéger son industrie ou son agriculture (en France, il suffit de songer au double tarif « Méline » de 1892), ni à faire varier les taux d’intérêt pour tenter de discipliner les phases du cycle économique.
Cependant, il faut rappeler également que ce modèle économique et politique n’eut qu’un temps. Comme toujours, les guerres et les crises ont joué dans les changements de structures et dans l’évolution de la société le rôle d’accélérateur.
Les rapports entre finances publiques et économie générale se sont en effet profondément transformés par la suite. La gestion plus ou moins administrée de l’économie a été l’idée sur laquelle les États ont fonctionné sans discontinuer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin des années 1970. Système qui avait ses traits culturels propres, faits de croyances et de modes de raisonnement aussi bien à l’intérieur de l’État que chez les agents économiques eux-mêmes. L’imbrication étroite de l’État dans le fonctionnement du marché, et ceci même dans les États les plus libéraux, était considérée comme un fait acquis. Il faut ajouter que cette action de l’État et des diverses collectivités publiques se prolongeait et se diffusait, par un effet de capillarité, à travers de multiples réseaux et de nombreux relais.
Or, depuis les années 1980, un peu plus tôt ou un peu plus tard selon les États, ce modèle subit, et là encore sous la pression des crises, une véritable métamorphose qui pourrait trouver son apogée dans les prochaines années.
La fin d’une période de croissance quasi ininterrompue, les Trente Glorieuses, l’échec des politiques d’inspiration keynésienne de lutte contre la crise, la nécessité de favoriser une allocation des ressources aussi efficace que possible au sein de la société, ont notamment conduit les États à remettre en cause les postulats de leur politique budgétaire et financière. Priorité a été donnée à l’environnement économique sur l’intervention directe, à la production sur la redistribution, à l’incitation sur le dirigisme, aux décisions décentralisées sur la réglementation globale.
À la culture d’inflation, traditionnellement ancrée dans le comportement des acteurs économiques, mais dont l’État avait aussi bénéficié et s’était servi pour favoriser des transferts de ressources, ont succédé des politiques de rigueur monétaire, axées sur le maintien de la stabilité des prix et la recherche d’une limitation des déficits budgétaires. Une idée s’est imposée, celle que l’État, quelle que soit la puissance des instruments financiers dont il disposait, ne pouvait à lui seul décréter la croissance, mais qu’en revanche, il pouvait, dans certaines conditions, la contrarier. Cette prise de conscience a conduit à une réhabilitation du marché, et à une réévaluation des interventions de l’État et de sa gestion.
Toutefois, il s’agit là d’un cap difficile à maintenir, on a pu le constater, notamment lorsque se produisent des crises financières (subprimes), sanitaires ou géopolitiques. Et il est là une raison suffisante pour que face à la transformation de leur environnement les responsables politiques et économiques prennent en compte des réalités obéissant à des logiques et à des implications contradictoires. Cette tension entre un modèle qui perdure et une société qui change suscite nécessairement des interrogations sur nos modes de penser l’État et l’économie.
C’est pourquoi, sauf une crispation sur une augmentation exagérée des droits de douane qui gênerait leurs intérêts, on peut supposer que par ses propos péremptoires et par ses actes Donald Trump soit susceptible de convaincre des décideurs politiques et économiques, encore hésitants et cela quel que soit le pays. Pour la même raison, les États qui expérimentent d’ores et déjà ce modèle comme les partis qui le portent sont encouragés à en poursuivre la logique. Sans compter les arguments relevant de la puissance économique et financière des États- Unis qui peuvent parfois se révéler très convaincants.
Quoi qu’il en soit, c’est sur fond de conflits mondiaux, de concurrence internationale intense et de développement à grande vitesse de l’intelligence artificielle que se dessinent à nouveau les prémisses d’un passage vers un autre ordre économique, politique et planétaire, autrement dit vers une autre époque.
Michel BOUVIER