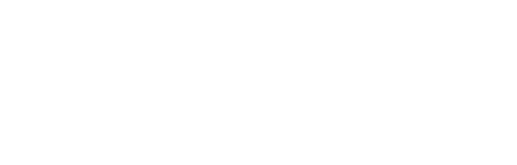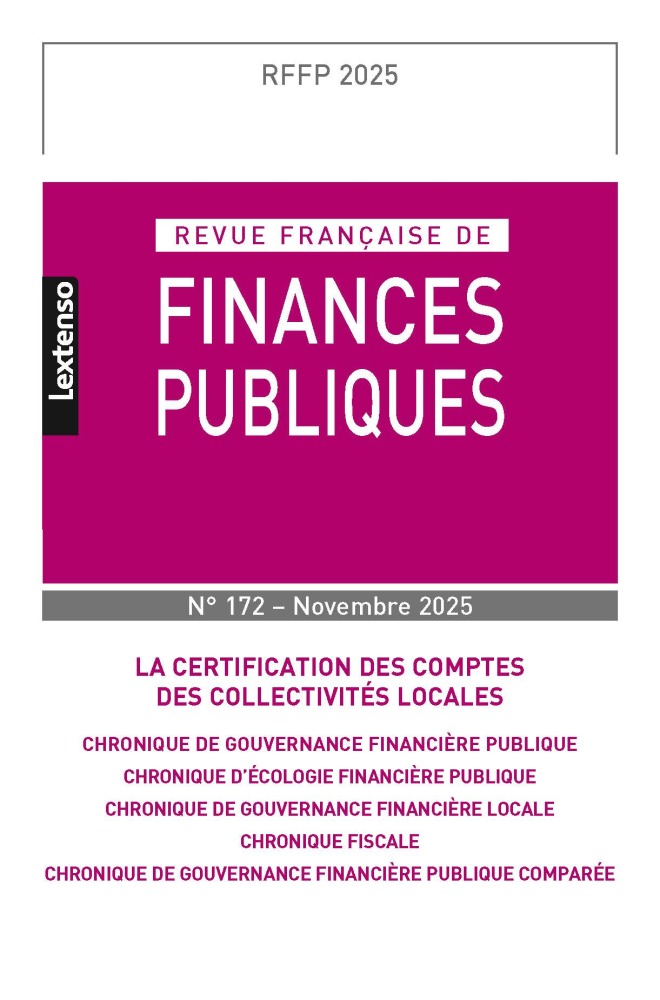Est-il donc insurmontable d’assainir les comptes publics ?
Assainir les comptes publics à un moment où les institutions sont durablement confrontées à la nécessité de s’inscrire dans une logique du mouvement et de l’incertain relève-t-il de l’impossible ? C’est la question que l’on peut se poser lorsque l’on considère les débats politiques actuels qui opposent les partisans inconditionnels d’une coupure dans les dépenses à ceux qui défendent farouchement une solution fiscale.
Or, le poids de plus en plus insupportable de la dette publique, les chocs à répétition et la refondation actuelle de l’ordre international font apparaître en pleine lumière l’urgence de sortir de cette impasse et dépasser des postures qui ne font qu’aggraver la situation.
Pour faire face à un tel défi, des institutions financières publiques solides sont indispensables car une gouvernance financière publique efficace est une condition majeure de la réalisation de l’équilibre d’une société ainsi que de la souveraineté de l’État. Or, aujourd’hui, l’un des enjeux cruciaux, dans ce monde en ébullition, est d’être en mesure d’assumer solidairement ce défi sur la base d’une culture du compromis.
Pour aller dans ce sens, il est indispensable de rompre avec une conception cloisonnée des finances publiques qui ne reconnaît pas, et a fortiori ne formalise pas, les multiples interactions et la multi- rationalité qui les caractérisent. Une approche unidimensionnelle ne peut que conduire à des analyses partielles faussement rationnelles engendrant des décisions inefficaces voire, à terme, un blocage du processus décisionnel, une paralysie du système qui se solde par une incapacité à en juguler les dérives.
En effet, le pilotage des finances publiques ne peut pas se limiter à ne considérer que le budget de l’État mais il doit prendre en considération l’ensemble composé de l’État, des organismes de Sécurité sociale et des collectivités locales. Au sein de cet ensemble les finances des unes rétroagissent sur celles des autres. Or, l’organisation actuelle de la distribution des pouvoirs ne reflète pas cette réalité.
Ce n’est qu’implicitement que les influences réciproques des structures financières publiques sont abordées. Il n’est pas affirmé clairement que leurs décideurs respectifs sont co-responsables d’une dette publique devenue insupportable, cela en grande partie parce que les décisions qui sont prises le sont dans des budgets séparés sans concertation commune préalable souvent sur fond de non-dits corporatistes et dans la méfiance. Il n’est jamais proposé la création d’un dispositif d’aide à la décision des pouvoirs politiques qui permettrait une coordination de leurs choix.
Plusieurs voies sont possibles. Dans l’immédiat, parce que le temps presse, une approbation simultanée, en conseil des ministres mais également au Parlement, des projets de loi de finances de l’État et de financement de la Sécurité sociale favoriserait une cohérence des analyses et des propositions. Pourrait y être joint sinon un éventuel projet de loi de financement des collectivités locales tout au moins un état de leurs prévisions financières.
Plus encore. Il serait judicieux, sur la base d’une méthodologie systémique, de créer une institution partenariale permanente de régulation des finances publiques intégrant des représentants de l’État, des collectivités locales, de la Sécurité sociale. Dotée d’un statut juridique et d’un groupe d’experts, cette institution d’aide à la décision ne limiterait pas son champ à la dépense publique mais inclurait également les ressources. Elle permettrait de partager des informations ainsi que de coordonner des politiques financières publiques aujourd’hui entravées par une dispersion des acteurs et des procédures. Elle contribuerait ainsi à proposer les politiques devant être privilégiées telles que celles correspondant à des besoins nouveaux ou urgents, qui contribuent à la compétitivité économique. Elle serait également un dispositif pertinent pour participer à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle intégrant de façon documentée et raisonnée l’ensemble des dépenses et des ressources publiques.
On ne doit pas s’y tromper, la société française a considérablement changé, la classe politique en est le reflet et la gouvernance des finances publiques en subit les conséquences ; elle est à la fois prisonnière de normes et d’une organisation qui ne correspondent plus au monde actuel et de surcroît abandonnée aux aléas d’enjeux politiciens exacerbés. Or, les faits obligent aujourd’hui à poser dans l’urgence la question des dépenses, de la dette publique, et de la fiscalité. Ce sont là des raisons suffisantes pour instituer une instance plurielle et partenariale, au sein de laquelle la question du sens et du contenu des politiques financières publiques ne pourrait pas faire l’économie d’un débat nourri de données fiables, objectives, et de propositions négociées. Marquée au sceau de la responsabilité, une telle institution faciliterait le déroulement des débats parlementaires.
Enfin, on peut raisonnablement penser que, dans le cadre d’un processus de décloisonnement de la décision budgétaire, il soit possible d’aller au-delà et que se dessine la mobilisation d’acteurs qui dépasse le premier cercle très restreint, celui des « spécialistes des finances publiques », et concerne un second cercle plus large, celui de l’ensemble des décideurs politiques et sociaux. Mieux. Dans un schéma démocratique idéal ce sont tous les citoyens qui devraient être amenés à comprendre les enjeux des finances publiques. Nous en sommes tous conscients, un tel objectif, développer une culture financière publique, nécessite beaucoup de pédagogie car il n’est pas de domaine plus rébarbatif ou incompréhensible aux profanes, et, parfois même disons-le, décourageant pour les experts lorsqu’il n’en est pas saisi toute l’importance pour la réalisation de l’intérêt général.
Michel BOUVIER