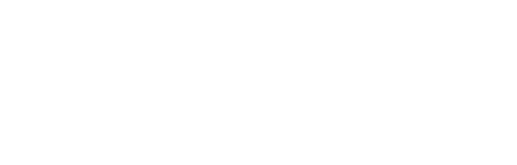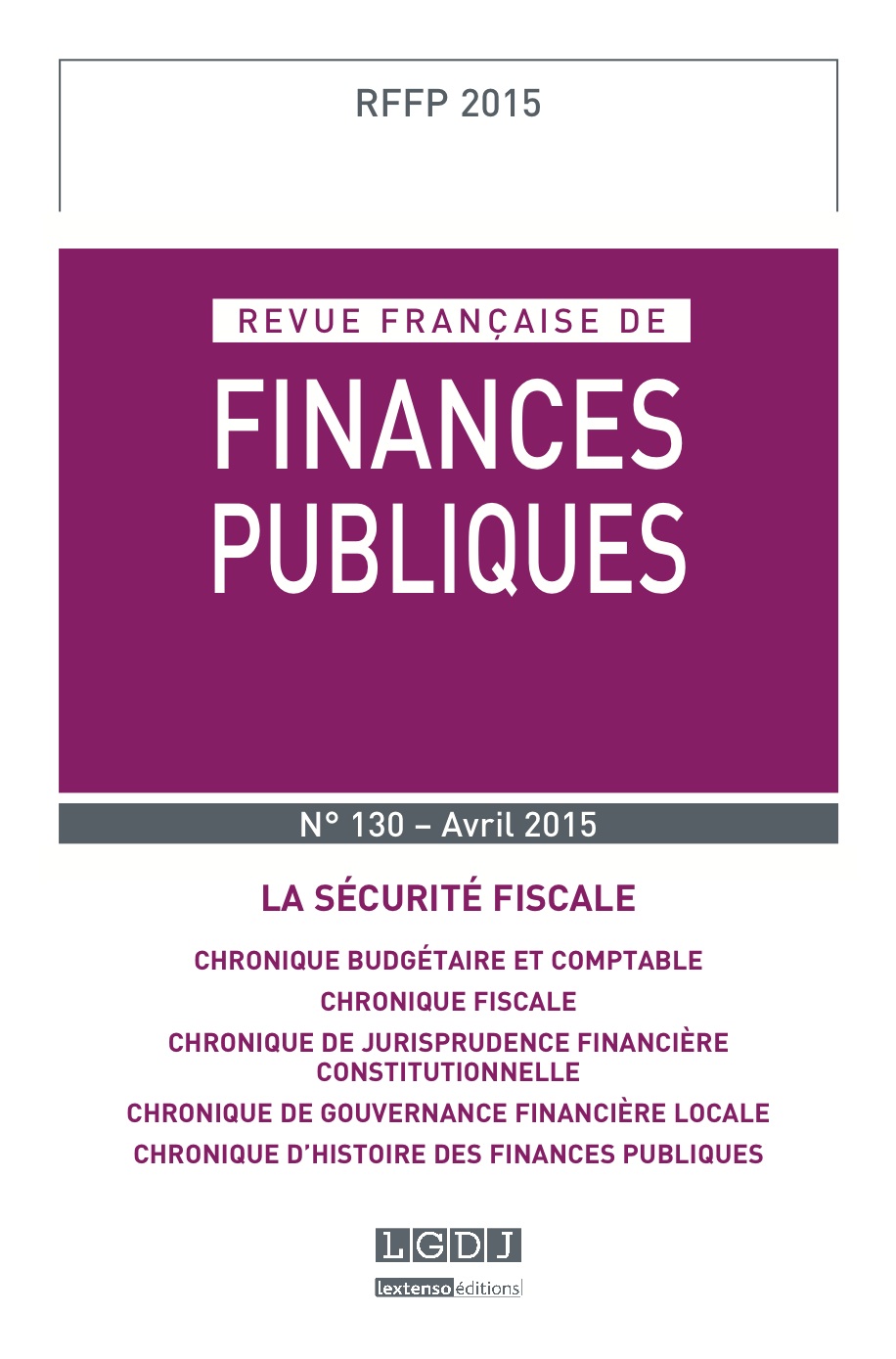Éditorial
La sécurité fiscale :
une politique publique à part entière
Il est indéniable que la sécurité fiscale se pense et s’élabore à travers des constructions juridiques. Toutefois son enracinement dans des méandres du droit de plus en plus complexes ne doit pas faire à oublier qu’au-delà de l’approche juridique, le sujet relève à part entière du champ des politiques publiques et d’un choix de société, au même au même titre que l’Éducation, la Défense, la Culture, la Santé, ou encore la Justice. Le champ concerné, l’impôt, en fait d’ailleurs un sujet particulièrement sensible. L’histoire l’a montré, la fiscalité peut donner lieu en effet à des atteintes graves aux droits fondamentaux. Si le temps n’est plus, fort heureusement, des exactions commises par ceux qui la décident ou la recouvrent, la question de la sécurité fiscale n’a pas pour autant disparu. Elle se pose avec acuité lorsque l’impôt prend un tour confiscatoire et affecte les capacités économiques des contribuables ou encore lorsque l’instabilité des règles est particulièrement forte mettant les contribuables dans l’incapacité de bâtir leur futur personnel ou celui de leur entreprise.
Or la sécurité en matière fiscale est essentielle à divers titres et si ses formes et son accomplissement dépendent au final des règles juridiques et des pratiques administratives qui la concernent, il convient avant tout de la considérer comme procédant d’un mode d’organisation de la société. Des valeurs politiques sont en jeu telles que celles qui ont trait à la tradition démocratique et à la protection des droits de l’homme. Des impératifs économiques sont également déterminants qui concernent tout autant le dynamisme de la consommation que celui des entreprises. Des considérations financières sont aussi à prendre en compte car l’insécurité fiscale a nécessairement des conséquences sur l’accomplissement par les contribuables de leurs obligations et peuvent obérer le recouvrement de l’impôt1. Il ne faut pas non plus oublier que le cadre d’action de la gestion de l’impôt par ceux qui en ont la charge doit être suffisamment clair pour qu’ils soient en mesure d’assurer correctement leur fonction. Enfin, le défaut de sécurité fiscale est susceptible d’engendrer divers comportements d’évitement de l’impôt, des révoltes certes mais aussi des délocalisations vers des États où l’assurance que les facteurs essentiels de cette sécurité sont au rendez-vous.
On le sait, le droit fiscal traduit sous la forme de normes des objectifs politiques, financiers, économiques, sociaux extrêmement variés. C’est la raison pour laquelle c’est un droit complexe dont les règles sont souvent difficiles à interpréter, la complexité de ce droit n’ayant d’égale que la variété des situations qu’il doit appréhender. C’est ce qui explique aussi à la fois sa complexité et son instabilité, le législateur étant conduit à multiplier les dispositions dérogatoires et à modifier constamment les règles établies. On voit également se multiplier les sources de ce droit, nationales et internationales, législatives, réglementaires, jurisprudentielles, de même qu’on voit aussi apparaître de nouveaux domaines, de nouveaux acteurs et de nouveaux problèmes. Il en résulte une extrême diversité ainsi que des règles d’assiette et de procédures souvent très compliquées qui renvoient une image complexe de la structure fiscale qui n’est pas du tout sécurisante. Comme l’a parfaitement mis en évidence le rapport Fouquet, « l’instabilité et la complexité de la norme fiscale sont les premières causes d’insécurité juridique : les changements fréquents de la loi et les difficultés qui apparaissent lorsqu’il s’agit de l’interpréter constituent une source de risque pour l’ensemble des contribuables dans leur relation avec l’administration fiscale comme dans l’appréhension de la dimension fiscale d’un projet économique »4.On l’a compris, c’est dans un cadre global que doit être replacée la question essentielle de la sécurité fiscale qui doit être appréhendée comme une véritable politique publique. C’est à ce prix que peut se trouver renouvelé le civisme fiscal et dynamisé le marché économique. Il est urgent, à notre sens, de poser avec fermeté que cette politique publique doit être clairement définie et identifiée comme telle au sein de la stratégie de l’État. Elle est en effet indispensable pour affirmer la légitimité de l’impôt aux yeux des contribuables effectifs ou potentiels. Une question essentielle et cruciale aujourd’hui.
Michel BOUVIER
1. A. Smith estimait déjà que la fiscalité devait être dotée de deux qualités essentielles :la clarté et la commodité. « La taxe, écrivait-il, ou portion d’impôt que chaque individu est tenu de payer doit être certaine et non arbitraire. L’époque du payement, le mode du payement, la quantité à payer, tout cela doit être clair et précis, tant pour le contribuable qu’aux yeux de toute autre personne ». Ce principe dit de certitude s’accompagnait d’un principe de commodité selon lequel « tout impôt doit être perçu à l’époque et selon le mode que l’on peut présumer les plus commodes pour le contribuable » (in Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776).
2. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
3. F. Luchaire, « La sécurité juridique en droit constitutionnel français », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 11‑2001.
4. « Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les
contribuables : une nouvelle approche », rapport Fouquet (2008).