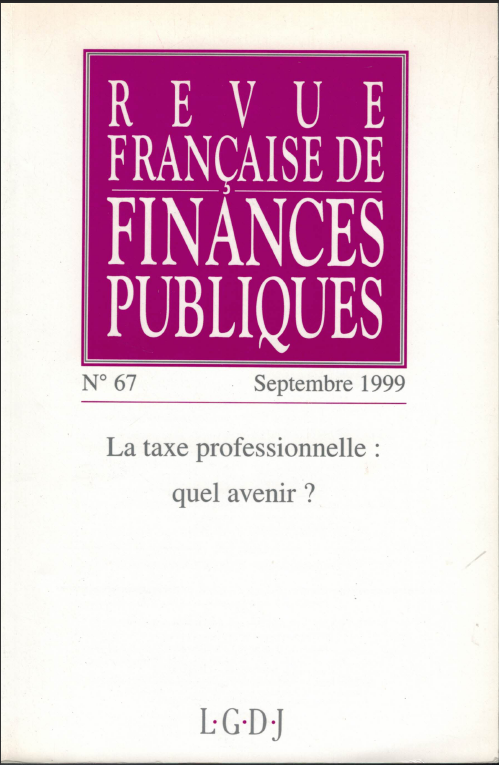ÉDITORIAL
La taxe professionnelle vient de faire l'objet d'une réforme qui exclut progressivement de la base imposable (de 1999 à 2003) la composante " salaires bruts versés par l'entreprise ".
La mesure n'a donné lieu d'une manière générale, ni avant ni après son adoption par le Parlement, à de spectaculaires levées de boucliers. Il est vrai que, justifiées ou non, les critiques faites à cet impôt depuis des années étaient devenues de véritables " classiques " avec un argument paraissant à priori imparable, à savoir le handicap que peut constituer cette taxe pour l'investissement et pour l'emploi. Reprises parfois par les plus hautes autorités de l'État, ces critiques avaient fini par faire de la taxe professionnelle une sorte de symbole même du " mauvais impôt ". On comprend alors que toute décision d'en limiter la portée, voire même de la supprimer, ait pu paraître comme allant de soi et procédant d'une logique inéluctable.
Or si l'illégitimité économique de la taxe professionnelle a toujours, on le sait, constitué le point fort du procès dont elle est l'objet, curieusement les conclusions des recherches scientifiques, tant en ce qui concerne la question de l'investissement que celle de l'emploi ou encore de la localisation des entreprises, restent somme toute très nuancées si l'on y regarde de près (cf. à ce sujet les travaux du Conseil des impôts qui figurent dans son rapport 1997) ; en tout cas, elles ne sont pas plus sévères que celles qui concernent d'autres impôts pesant sur l'entreprise.
Beaucoup plus fondées en revanche apparaissent les reproches insistant sur le fait que la taxe professionnelle figure très certainement parmi les impôts les plus compliqués à établir et qu'il s'ensuit un coût non négligeable aussi bien pour l'État (formation des agents, gestion de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement) que pour les entreprises (coût d'établissement de l'impôt dû, optimisation de la charge donnant généralement lieu au recours à un conseil).
À cet égard et si l'objectif était surtout de rechercher une simplification du système fiscal français, cet objectif à lui seul serait largement suffisant pour disqualifier un impôt comme la taxe professionnelle, celle-ci étant à l'évidence un obstacle dans la recherche d'une plus grande rationalité de la gestion des finances publiques.
S'il est indéniable que la voie qui vient d'être choisie va précisément dans cette direction, allant parallèlement à contre sens d'une accentuation de l'autonomie des collectivités locales, c'est surtout le renforcement du contrôle des finances locales qui paraît en être sa caractéristique essentielle. À travers la réforme de la taxe professionnelle, c'est avant tout en effet la restructuration du dispositif de contrôle du système financier local qui est en jeu, et à travers elle c'est celui des finances nationales, et finalement de l'État, qui est également concerné.
Michel Bouvier