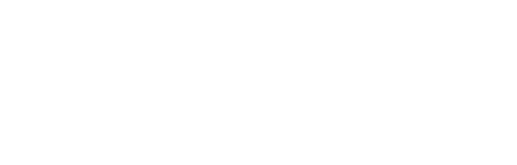Éditorial
Les ambiguïtés fatales du droit public financier
« Les questions financières ont toujours eu une importance considérable, mais elles en ont pris, en France, une plus considérable encore depuis une vingtaine d'années. Cette importance s'explique avant tout par l'énormité de nos budgets annuels et de notre dette publique » [1] Cette remarque, qui date de 1906, peut parfaitement et en tous points être reprise aujourd'hui, toutes proportions gardées bien entendu. On assiste depuis plusieurs décennies à une succession de crises des finances publiques. Celles-ci ont donné lieu à des réformes qui ont profondément changé la nature d'une discipline universitaire jusqu'alors très marquée aux coins du droit public mais qui n'en ont pas pour autant freiné le déclin.
Identifiées à la législation financière, les finances publiques ont été traditionnellement plus soucieuses de régularité des opérations budgétaires que d'efficacité de la gestion. En France, ce n'est que relativement récemment que ce besoin s'est fait sentir et surtout que des pratiques empruntées au management privé ont été adaptées à la gestion publique. C'est bien une sorte de révolution qui s'est alors produite par rapport à la conception antérieure.
Il faut en effet se rappeler qu'à la suite de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui a posé un certain nombre de principes relatifs aux ressources de l'État ainsi qu'au contrôle des deniers publics, un droit budgétaire, comptable et fiscal s'est progressivement constitué au xixe siècle. Un corpus de normes fut alors bâti que l'on s'est attaché à enseigner, à étudier et à parfaire dans le but de gérer au mieux les intérêts du pays. Une « commission des études de droit », installée par un arrêté du 1er février 1878, estimait même nécessaire un enseignement des finances publiques. Celui-ci, était-il précisé, « ne pourrait manquer de plaire aux esprits élevés, et à coup sûr, il multiplierait les hommes capables de gérer à un degré quelconque les intérêts du pays » [2] ainsi que de poursuivre un projet politique libéral plaçant au premier plan le rôle du Parlement et rompant avec l'opacité qui caractérisait les finances de l'Ancien Régime. Un enseignement des finances publiques apparaissait d'autant plus indispensable, estimait encore la commission, que la France était « un pays où l'ignorance des questions financières est générale et où pourtant la vie publique est ouverte à tous » [3]. On aurait pu être en droit d'attendre de cette entrée des finances publiques dans l'université qu'elle installât solidement la discipline. Or, outre que cette entrée ne se fit pas très facilement [4], l'enseignement connut par la suite nombre de vicissitudes qui n'ont fait que se développer jusqu'à nos jours.
En effet, tandis que la toute nouvelle École libre des sciences politiques inscrivait en 1870, quasiment dès sa création, des cours de finances publiques [5] dans ses programmes, il fallut attendre 1889 (décret du 24 juillet 1889) pour que la matière pénètre au sein des facultés de droit [6]. Ce n'est qu'en 1924/1925 que le cours de « législation financière » fut rendu obligatoire. Aujourd'hui si l'enseignement des finances publiques s'est diversifié au sein des universités c'est de manière très inégale. Quoi qu'il en soit des situations particulières, le constat peut être fait que les cours de finances publiques générales et plus encore ceux de comptabilité publique ne cessent de voir se réduire l'espace qui leur est accordé.
Cette place au sein des facultés de droit qui fut attribuée initialement aux finances publiques, même si elle a toujours été mineure, a semble-t-il masqué la tension, déjà présente au xixe siècle, entre la composante juridique de la matière et sa composante économique qui s'affirmera au fur et à mesure du développement de l'interventionnisme public. Par ailleurs, l'envol des sciences économiques sous leur propre bannière, avec leurs propres facultés, n'a pas pour autant conduit les juristes à s'interroger sur ce qui pouvait faire la spécificité du droit public financier. Et les ouvrages de Science et législation financière, qu'ils soient écrits par des juristes ou par des économistes, ne feront finalement que masquer une confusion et l'incapacité des uns et des autres de constituer une discipline indépendante, autrement dit de réunir la science financière longtemps enseignée par les économistes et la législation financière, affaire des juristes.
Depuis ce rendez-vous manqué, les finances publiques se sont enfoncées dans le quiproquo. Un quiproquo qui s'est trouvé accentué par l'abandon de l'appellation « législation financière » ou plus encore par le refus de s'approprier celle de « droit public financier » et se retrouver ainsi aux côtés du droit administratif, du droit constitutionnel, etc. La période « keynésienne » a certainement été pour beaucoup dans cette insouciance quant à l'avenir de la discipline tant l'État et ses finances étaient présents dans tous les secteurs de la société. Finalement, il ne semblait nul besoin d'approfondir leur spécificité juridique ou économique, nul ne souhaitait lever l'ambiguïté. Or, l'avenir des finances publiques était précaire car lié à la centralisation, à la croissance économique et disons-le à l'optimisme ambiant quant au futur.
C'est avec la crise de l'État-providence que la question de la tension entre efficacité et régularité, ou encore entre droit et gestion, va se poser de façon cruciale. La nécessaire réduction des déficits publics a ouvert la gestion publique à la culture de la performance. Les finances publiques ont été immédiatement confrontées au changement de conception de l'économie – on veut dire sa libéralisation – qui s'est développé à partir de la seconde moitié des années 1970. Et si leurs aspects économiques ont été considérablement remis en question par une critique sérieuse des interprétations keynésiennes, c'est le droit public financier qui s'est trouvé particulièrement affecté, voire même fondamentalement contesté. En effet, d'une manière générale, le droit public a ressenti les effets d'un changement de modèle économique engendrant un retrait de l'État et une montée en puissance du secteur privé et de la contractualisation. Mais, c'est en particulier le droit public financier qui, du fait de sa grande proximité avec les enjeux et les mutations économiques, a été aux avant-postes des mutations du secteur public.
À cela est venue s'ajouter une extension des finances publiques hors des frontières de l'État, vers les collectivités locales, la sécurité sociale, l'Union européenne, voire même hors des frontières du secteur public avec la démultiplication de partenariats public/privé et par conséquent un éclatement de la discipline avec de surcroît un droit fiscal qui tend à prendre son envol.
Aujourd'hui comme hier, les finances publiques se trouvent placées au cœur des grandes questions qui se posent aux sociétés contemporaines. Toutefois cette présence que l'on peut constater dans tous les domaines de la vie publique ou privée ne se traduit pas par un renforcement de la discipline. Au contraire, à peine de lui reconnaître une identité propre celle-ci pourrait bien disparaître en tant que telle du fait d'un éparpillement de ses multiples composantes au sein d'autres champs disciplinaires.
Pour cette raison il n'est pas pertinent et il est même contre-productif de les cantonner, comme ce fut le cas autrefois, à leurs aspects juridiques, ou comme c'est le cas aujourd'hui, à leurs implications économiques ou gestionnaires alors qu'il s'agit d'un champ foncièrement interdisciplinaire. L'absence d'approche globale des finances publiques met dans l'incapacité d'en comprendre le véritable sens et l'unité d'ensemble ; comme elle prive celui qui porte un intérêt à certains aspects (fiscalité, finances communautaires, finances locales, finances sociales) de la possibilité d'en saisir la cohérence et les finalités.
Par voie de conséquence la variété des finances publiques se trouve réduite à un ensemble de techniques économiques, gestionnaires ou juridiques, cette approche ayant contribué à renforcer de fausses certitudes. Totalement caricaturale, cette image technicisée des finances publiques a conduit trop souvent à reléguer la matière au rang des disciplines accessoires, voire à la délaisser, alors qu'elle mérite d'être reconsidérée. Sans doute convient-il au préalable d'en réhabiliter une conception moins technique permettant d'en discerner le sens, autrement dit la raison d'être. Il importe d'abord de resituer les finances publiques dans le cadre d'un processus de fonctionnement politique entendu au sens large comme la vie et l'organisation d'une société dans son ensemble. Autrement dit, c'est le caractère politique des finances publiques qui doit en premier lieu être compris. Celles-ci en effet constituent le noyau dur et la substance des pouvoirs politiques, elles en déterminent la puissance et l'évolution. Plus largement encore, elles sont à la source des directions qui sont prises en matière économique et sociale parce qu'elles expriment des choix de société.
Ce n'est qu'à ce prix, au sein de cet ensemble que le droit public financier peut espérer se perdurer en tant que tel. Il y a là un défi de taille à relever car l'extrême hétérogénéité et la complexité des finances publiques exigent une appréhension globale et la mise en œuvre d'une grande variété de savoirs, impliquant un travail commun de chercheurs appartenant aux disciplines les plus diverses [7]. Il s'agit peut-être là de l'obstacle le plus sérieux que rencontre cette discipline. Faute de pouvoir le surmonter, elle est d'ores et déjà écartelée, voire même éclatée, on l'a dit, en ne cessant de se chercher des points d'ancrage sans cependant rencontrer un réel succès.
Cette « errance », significative de ses multiples facettes va à contresens de la construction d'une discipline solidement implantée au sein de l'université, et plus largement de la société, comme le sont les sciences juridiques, économiques, ou politiques. On peut même craindre que ne se soit enclenché, ou plutôt accéléré, un irrémédiable processus d'obsolescence. Dans cette hypothèse le droit public financier, parce qu'il est un droit multipolaire, présent dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous comme de nos institutions publiques ou privées, serait susceptible au mieux de se dissoudre au sein de divers droits.
On peut craindre aussi qu'il n'y tienne qu'une place secondaire, victime d'une image qu'il n'aurait pas su modifier [8]. Une évolution qui serait éminemment paradoxale eu égard à la place majeure des finances publiques comme chacun peut le voir aujourd'hui.
Michel Bouvier
[1] E. Bouvier, La science et la législation financière dans les facultés de droit, LGDJ, 1906.
[2] P. Lavigne, in « Le centenaire de l'enseignement des finances publiques dans les facultés de droit », RFFP N° 28-1989.
[3] P. Lavigne, art. cit.
[4] Cf. F. Waserman, Les doctrines financières publiques au xixe siècle, LGDJ, coll. Bibliothèque de finances publiques et de fiscalité, 2012
[5] « Systèmes financiers des principaux États », « Revenus publics et impôts », « Organisation des services financiers et règles de la comptabilité publique ».
[6] Cf. E. Bouvier, La science et la législation financière dans les facultés de droit, LGDJ, 1906.
[7] « La complexité des problèmes financiers, lorsqu'on veut les étudier dans leur ensemble, est telle que leur étude présente les plus grandes difficultés. Non seulement il n'est pas toujours aisé de résoudre les questions purement économiques, mais encore les facteurs politiques et sociaux semblent parfois rendre les problèmes inextricables » (G. Jèze, Cours de finances publiques, Giard, 1925).
[8] Cf. M. Bouvier, Tradition et modernité des finances publiques, in RFFP N° 41-1993.