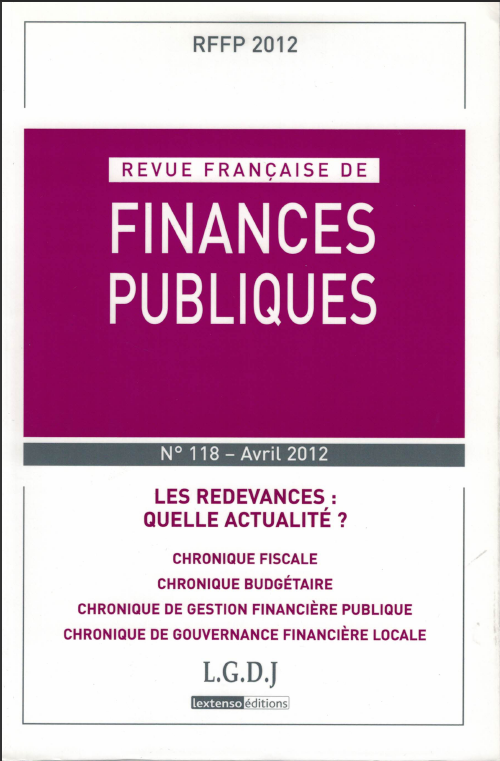La soutenabilité des finances publiques en déficit de projet politique
On peut s'étonner alors que la situation de crise économique, financière et sociale est quasi permanente depuis la seconde moitié des années 1970, que durant tout ce laps de temps aucune solution efficace n'y ait jamais été apportée. Ce n'est pas faute pourtant que les points de vue – plus ou moins péremptoires – se soient exprimés sur le sujet, des points de vue souvent repris à l'identique par les générations qui se sont succédé durant cette période, les annonces de « sortie de crise » ne se comptant plus et les remèdes préconisés se révélant sans grande efficacité bien que tous marqués paradoxalement au coin d'une culture de la performance. Pour tous ceux qui ont suivi d'année en année cette situation de crise qui depuis près de quarante ans n'en finit pas de rebondir, de s'étendre et de s'aggraver, force est de se demander si la question de sa résolution est bien posée.
Il serait déjà plus exact nous semble-t-il de considérer que nous sommes face à une longue période de transition ce qui permettrait d'appréhender et intégrer les crises dans une logique globale qui se déroule et de mieux en identifier le sens général. En effet, les réponses au coup par coup qui sont apportées, l'absence de projet d'ensemble, reflètent un mode de pensée par trop analytique, autrement dit un réel déficit de synthèse et d'audace politique.
Bien conscient qu'une telle synthèse nécessite une réflexion qui dépasse un simple éditorial, on observera toutefois que c'est bien l'organisation politique de la société qui est au cœur du processus. On veut dire tout aussi bien les représentations que l'on peut s'en faire que le contenu et le rôle que l'on souhaiterait lui donner. Il est par exemple excessif de réduire l'État à la fonction ou place qu'il devrait ou non tenir au sein du marché. Il est tout aussi réducteur d'enfermer les finances publiques dans un cadre unilatéral, juridique ou économique. Les concepts de déficit public, de dette publique, de prélèvement obligatoire ou plus globalement de soutenabilité des finances publiques, sont des concepts qui tout en comportant des aspects très techniques sont d'ordre politique. Et l'approche que l'on en a dépend étroitement de la manière dont on conçoit le sens de la vie en société.
Sur ce plan, il convient de rappeler que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1980 l'intervention de l'État a été la règle dans tous les pays, mais sans doute en France plus qu'ailleurs. Or ce modèle qui avait commencé à être pensé comme un moteur du progrès et expérimenté avant la Seconde Guerre mondiale, a subi une véritable métamorphose lorsque, à la fin des années 1970 sous les effets des deux « chocs pétroliers », s'est développée une crise des finances publiques et qu'il a été jugé indispensable d'« affamer la bête »
[1]. En liaison avec l'augmentation accélérée et continue des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires qui s'est alors produite, il est apparu nécessaire de maîtriser ce processus pour endiguer l'explosion des déficits et de l'endettement.
C'est ainsi que la fin d'une période de croissance économique quasi ininterrompue (les « Trente Glorieuses ») a conduit à remettre en cause les postulats keynésiens des politiques budgétaires et à s'orienter, sans grand débat, vers une conception libérale classique mettant en avant la neutralité de l'État au regard du marché. Selon ce nouveau paradigme, la nécessité d'un équilibre des dépenses et des recettes, d'une « règle d'or »
[2], s'est vite présentée comme indispensable à la soutenabilité des finances publiques. Ainsi, dès le début des années 1980, il a été finalement admis que l'État ne pouvait à lui seul décréter la croissance et qu'il était même susceptible de la contrarier. Cette optique a conduit à une réhabilitation du marché, et à une réévaluation à la baisse des interventions publiques. La gestion des finances publiques françaises est alors devenue d'autant plus complexe qu'elle a dû prendre en compte deux réalités aux implications contradictoires : le poids de l'État, d'une part, et la transformation de son environnement économique et financier de l'autre.
Cette tension entre un modèle économique et politique qui perdurait et un environnement général, national et international qui tendait à en faire naître un autre a suscité des interrogations, tant sur les modes de gestion publics, que sur le caractère centralisé de l'État et sa place dans l'économie. C'est ainsi que, dans un premier temps, l'État s'est désengagé d'une partie de ses fonctions sur les collectivités locales en vertu du principe de subsidiarité et a poursuivi ce processus par une politique de privatisations et de déréglementation. Puis, progressivement, jusqu'aux années 2000, une autre conception de la gestion financière publique s'est imposée qui a consisté à prendre modèle sur le management des entreprises en en transposant les méthodes dans le secteur public.
Or, ce changement de modèle n'a pas complètement répondu aux attentes. Les déficits et l'endettement publics n'ont jamais été aussi élevés et la croissance économique comme on le sait n'est toujours pas au rendez-vous. C'est bien la preuve qu'il ne peut être question de prétendre élaborer une dogmatique scientifique, pas plus s'agissant des finances publiques que d'autres domaines. Nos sociétés forment des ensembles complexes, des systèmes au sein desquels les processus de décision ne sont pas linéaires mais multirationnels
[3]. Il est un fait que cette réalité a puissamment contribué à inscrire doute et relativisme dans les interprétations et les décisions et à provoquer une sorte d'engouement pour la technique et la pratique comme seul et unique point d'ancrage et moyen de maîtrise. G. Jèze, il y a près de trois quarts de siècle mettait déjà en garde contre une telle illusion : «
Il ne
faut pas cesser de le répéter, écrivait-il,
la simple pratique sans connaissance scientifique, c'est l'empirisme et la routine... Ceux qui n'ont pas médité longuement avec la méthode scientifique sur les problèmes financiers sont incapables de diriger les finances publiques d'un État : il leur est matériellement impossible de trouver les solutions des grands problèmes financiers. Ils manquent de hardiesse ; ils s'en tiennent à ce qui existe ; ils s'arrêtent au détail »
[4]. Autrement dit, l'empirisme, expression d'un imaginaire technique, ne peut faire loi.
D'un autre côté, tout paraît concourir à faire la preuve que l'environnement est devenu très largement incertain, que la gamme des choix possibles est si étendue que le succès des décisions prises relève très largement de l'improbable. Toutefois, s'il était fait une application triviale d'un tel principe d'incertitude, aucun projet de société ne pourrait plus s'envisager sachant aussi qu'à partir du moment où la certitude de l'incertitude apparaît paralysante en affirmer le principe est tout à fait contradictoire. C'est bien pourquoi il convient de ne pas négliger cette part d'imaginaire politique qui nourrit les grands projets de société et qui en est l'un des moteurs les plus puissants. Mais il ne faudrait pas non plus que cet imaginaire se trouve refoulé par une vénération de techniques financières conduisant à négliger ce que le philosophe Paul Ricoeur a qualifié de « bonne vie ».
Face à un environnement social explicitement présenté ou implicitement accepté comme s'auto-organisant selon des connexions multiples aux conséquences imprévisibles, il est certes devenu difficile de justifier toute forme de volontarisme politique. Il est un fait que le sens de cet environnement ne peut plus être pensé que dans la « connaissance de notre ignorance » comme l'a excellemment exprimé H. Atlan
[5]. Ce qui au final rend légitime et même indispensable que soit proposé aux électeurs un projet construit concernant les finances publiques et non des mesures éparses sans logique d'ensemble apparente.
Michel Bouvier
[1] L'expression “Starve the beast” a été employée plusieurs fois par des auteurs américains ; notamment dans les années 1970 par un économiste de l'École du Public Choice ainsi que dans les années 1980 par un journaliste duWall Street journal.
[2] Cf. RFFP n° 117-Février 2012.
[3] Cf. les travaux d'E. Morin. V. aussi L. Von Bertalanffy,
Théorie des systèmes, Dunod 1979 ; H. Simon,
La Science des systèmes, EPI, 1974 ; L. Sfez,
Critique de la décision, A. Colin, 1973.
[5] H. Atlan,
À tort et à raison, Seuil, 1989.